 Voilà que je continue mon exploration de l'oeuvre d'Italo Calvino, laquelle a commencé avec mes premièrers grosses lectures adultes, à l'âge de 14 ans. Cette fois-ci, entre le recueil inachevé (il devait porter sur les cinq sens, et n'en raconte que trois) Sous le soleil jaguar, et le très oulipesque Le château des destins croisés que je viens de commencer (je verrai si j'arrive à en dire quelque chose une fois que je l'aurai fini, il semble y avoir matière) j'ai entamé une lecture qui comprend à la fois relecture et découverte d'inédits.
Voilà que je continue mon exploration de l'oeuvre d'Italo Calvino, laquelle a commencé avec mes premièrers grosses lectures adultes, à l'âge de 14 ans. Cette fois-ci, entre le recueil inachevé (il devait porter sur les cinq sens, et n'en raconte que trois) Sous le soleil jaguar, et le très oulipesque Le château des destins croisés que je viens de commencer (je verrai si j'arrive à en dire quelque chose une fois que je l'aurai fini, il semble y avoir matière) j'ai entamé une lecture qui comprend à la fois relecture et découverte d'inédits.
Cosmicomics : récits anciens et nouveaux ne doit pas être confondu avec le recueil appelé simplement Cosmicomics (les titres italiens sont moins ambigüs : Le Cosmicomiche / Tutte le Cosmicomiche). Il s'agit en effet de l'intégrale, paru en 1997 en italien et en 2001 en français, du cycle de Cosmicomics que Calvino a commencé dans les années 60 ; on y trouve, outre Comsicomics donc, celui que j'ai déjà lu depuis de longues années, les recueils Temps zéro, Autres histoires cosmicomiques et Nouvelles histoires cosmicomiques, ces dernières ne comptant que deux nouvelles.
Le fil rouge de ces recueils est assez difficile à résumer : chaque récit commence par un paragraphe tiré d'un ouvrage scientifique, portant sur le passé de l'univers ou de la terre. Est-ce une conférence ? On ne sair pas précisément, toujours est-il que ce discours est interrompu à chaque fois, didascalie à l'appui, par un personnage répondant au nom imprononçable de Qwfwq (c'est une constante parmi les mystérieux congénères, ou en tout cas contemporains de ce dernier, d'avoir des noms défiant la prononciation, voir la lecture). On ne saura jamais qui ou ce qu'est Qwfwq, mais il est d'un âge plus que vénérable, puisqu'il est témoin de chacune des époques dont il est question, même celle de la naissance de l'univers, en passant par celle des dinosaures, celle de la conquête de la terre ferme...
J'avais cité, dans ma chronique des Villes invisibles du même auteur, une critique plus officielle qui parlait à propos de Cosmicomics d'une "poésie plus métaphysique que pataphysique (malgré les apparences)". C'est tout à fait ça : le roman réussit une synthése parfaite entre une poésie burlesque et un aspect spéculatif très cérébral, l'un comme l'autre étant poussé bien plus loin que pour Les Villes invisibles...enfin, une synthése moins parfaite pour certains textes : j'ai tout juster supporté l'austérité des deux Nouvelles histoires cosmicomiques (qui ont l'excuse d'être bien postérieures aux précédents recueils), et en revanche j'ai lâché l'affaire pour les deuxième et troisième partie de Temps zéro, beaucoup trop arides à mon goût. Du coup je ne sais même pas de quoi parle au juste la troisième partie éponyme du recueil, si ce n'est que, tout comme la dernière des Autres histoires cosmicomiques, elle ne semble pas avoir de rapport direct, ou de rapport tout court, avec la trame du cycle. Ca me console, d'un côté, et puis il reste la première partie du recueil, du niveau des deux meilleurs tomes du cycle. Il me faut quand même avouer que du point de vue de l'aridité, Calvino est sans cesse sur une corde raide, mais la plupart du temps, il arrvie à s'y tenir.
J'ai tenu quoi, trois paragraphes ? Il me faut maintenant renouer avec la "michaumanie" qui a marqué les premiers mois de ce blog. Ca faisait longtemps que je n'avais pas comparé des oeuvres, même surréalistes, à du Henri Michaux, tiens. Le cycle de Cosmicomics partage à mes yeux deux traits communs essentiels avec bien des cycle de récits du poéte belge : d'une part, le refus de la cohérence, les nouvelles se contredisent systématiquement les unes les autres, que ce soit sur l'âge de Qwfwq ou sur les événements dont il a été témoin, d'autre part un délire qui défie la visualisation, ce qui en fait peut-être le "roman" le plus étrange de Calvino, et un des plus grands OLNI du XXe siècle.
Pour finir, il fautr bien dire que Calvino montre de la suite dans les idées avec ces recueils : on ne compte plus les nouvelles qui fonctionnent sur le même canevas, celui d'une incompatibilité de goûts et de caractères entre le narrateur Qwfq et l'une des ses anciennes compagnes, ce qui cause leur séparation avec les transformations du monde. Il faut tout le génie de Calvino pour rendre ce motif pas répétitif pour deux sous.
Pas le versant le plus accessible de l'oeuvre de Calvino, certes : la pente est bien plus ardue encore que pour Les Villes invisibles. Mais ça mérite de s'accrocher.



 Encore une soirée Bon chic, mauvais genre ! Qui, comme son titre l'indique, est une soirée de Noël, avec des films qui permettent d'échapper un peu à la mièvrerie dont on nous inonde en cette période de l'année, et encore une fois deux fims n'ayant rien à voir entre eux.
Encore une soirée Bon chic, mauvais genre ! Qui, comme son titre l'indique, est une soirée de Noël, avec des films qui permettent d'échapper un peu à la mièvrerie dont on nous inonde en cette période de l'année, et encore une fois deux fims n'ayant rien à voir entre eux.  Lors de la
Lors de la  C'est pas pour dire, mais ça manque un peu de série B décontractée du slip sur ce blog, que ce soit en film ou en livre, et c'est pourtant pas faute d'en lire / regarder. Il est temps d'y remédier.
C'est pas pour dire, mais ça manque un peu de série B décontractée du slip sur ce blog, que ce soit en film ou en livre, et c'est pourtant pas faute d'en lire / regarder. Il est temps d'y remédier.  Les suites, qui n'ont aucun rapport avec le premier ni entre elles du point de vue de l'intrigue, et n'ont en commun que le thème de la maison hantée et un certain goût de la fantaisie, sont, sans surprises encore une fois, nettement moins bonnes, mais le second, House II, la deuxième histoire, réalisé en 1987 par Ethan Wiley, est encore honorable.
Les suites, qui n'ont aucun rapport avec le premier ni entre elles du point de vue de l'intrigue, et n'ont en commun que le thème de la maison hantée et un certain goût de la fantaisie, sont, sans surprises encore une fois, nettement moins bonnes, mais le second, House II, la deuxième histoire, réalisé en 1987 par Ethan Wiley, est encore honorable.  Mazette, ça faisait une éternité que je n'avais pas chroniqué une soirée Bon chic, mauvais genre. Je crois bien que ça fait
Mazette, ça faisait une éternité que je n'avais pas chroniqué une soirée Bon chic, mauvais genre. Je crois bien que ça fait  Je vais me faire plein d'amis, mais j'avais jusque là toutes sortes de mauvaises raisons de ne pas m'intéresser aux légendes bretonnes. Les régionalistes qui nous les cassent grave avec, pour commencer, et aussi la lourde tendance de la culture mainstream franchouillarde à se référer systématiquement à la péninsule dés qu'il est question de légendes rurales, au point d'en faire un poncif éculé. Etant donné que l'on a pas assez d'une vie pour découvrir tous les trésors mythologiques du monde, j'avais donc tiré prétexte de ces mauvaises raisons pour négliger la Bretagne, sauf à travers mes lectures parlant un peu plus généralement du légendaire français. Mais bon, comme il ya quelques mois j'ai lu les deux recueils de contes basques de chez Aubéron, je me suis dit que j'allais aussi m'intéresser à la Bretagne de façon, euh, "autonome".
Je vais me faire plein d'amis, mais j'avais jusque là toutes sortes de mauvaises raisons de ne pas m'intéresser aux légendes bretonnes. Les régionalistes qui nous les cassent grave avec, pour commencer, et aussi la lourde tendance de la culture mainstream franchouillarde à se référer systématiquement à la péninsule dés qu'il est question de légendes rurales, au point d'en faire un poncif éculé. Etant donné que l'on a pas assez d'une vie pour découvrir tous les trésors mythologiques du monde, j'avais donc tiré prétexte de ces mauvaises raisons pour négliger la Bretagne, sauf à travers mes lectures parlant un peu plus généralement du légendaire français. Mais bon, comme il ya quelques mois j'ai lu les deux recueils de contes basques de chez Aubéron, je me suis dit que j'allais aussi m'intéresser à la Bretagne de façon, euh, "autonome". 
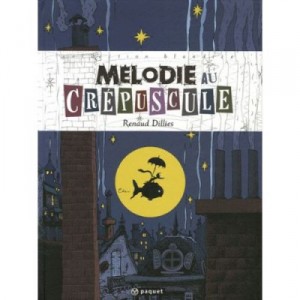 Parmi les autres traits récurrents dans cet univers, on peut noter l'omniprésence du jazz, passion contagieuse de l'auteur, et une verve anticonformiste et même libertaire (sans vouloir trop m'avancer, on me dirait que Dilliès est anar que je n'en serais pas autrement étonné, en tout cas certains passages de Betty Blues y font fortement songer).
Parmi les autres traits récurrents dans cet univers, on peut noter l'omniprésence du jazz, passion contagieuse de l'auteur, et une verve anticonformiste et même libertaire (sans vouloir trop m'avancer, on me dirait que Dilliès est anar que je n'en serais pas autrement étonné, en tout cas certains passages de Betty Blues y font fortement songer). 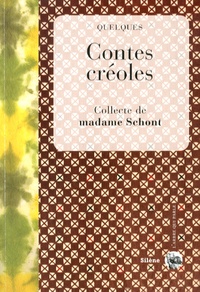 Jusque là, je conaissais surtout les trésors mythologiques des Amériques par leur versant améridindien, ce qui est sans doute le plus passionnant du point de vue de l'éloignement cutlurel. Je ne connaissais le folklore de "colon" que par quelque bribes, notamment chez Borges (ainsi des joliment absurdes histoires de bûcherons des Etats-Unis sur une faune fantaisiste et burlesque), plus des mentions dans des études folkloriques, et plus récemment les recueils de Praline Gay-para (
Jusque là, je conaissais surtout les trésors mythologiques des Amériques par leur versant améridindien, ce qui est sans doute le plus passionnant du point de vue de l'éloignement cutlurel. Je ne connaissais le folklore de "colon" que par quelque bribes, notamment chez Borges (ainsi des joliment absurdes histoires de bûcherons des Etats-Unis sur une faune fantaisiste et burlesque), plus des mentions dans des études folkloriques, et plus récemment les recueils de Praline Gay-para ( De ce premier roman de Jean-Pierre Andrevon, je ne conaissais jusque là que l'adaptation en film d'animation par René Laloux, sous le tire Gandahar (devenu depuis le titre du roman, mais je resterai fidèle aux Hommes-machines contre Gandahar, titre de l'édition que j'ai lu) film dont j'avais parlé
De ce premier roman de Jean-Pierre Andrevon, je ne conaissais jusque là que l'adaptation en film d'animation par René Laloux, sous le tire Gandahar (devenu depuis le titre du roman, mais je resterai fidèle aux Hommes-machines contre Gandahar, titre de l'édition que j'ai lu) film dont j'avais parlé  Je dois commencer cette chronique par un mea culpa : lors de ma précédente chronique de
Je dois commencer cette chronique par un mea culpa : lors de ma précédente chronique de