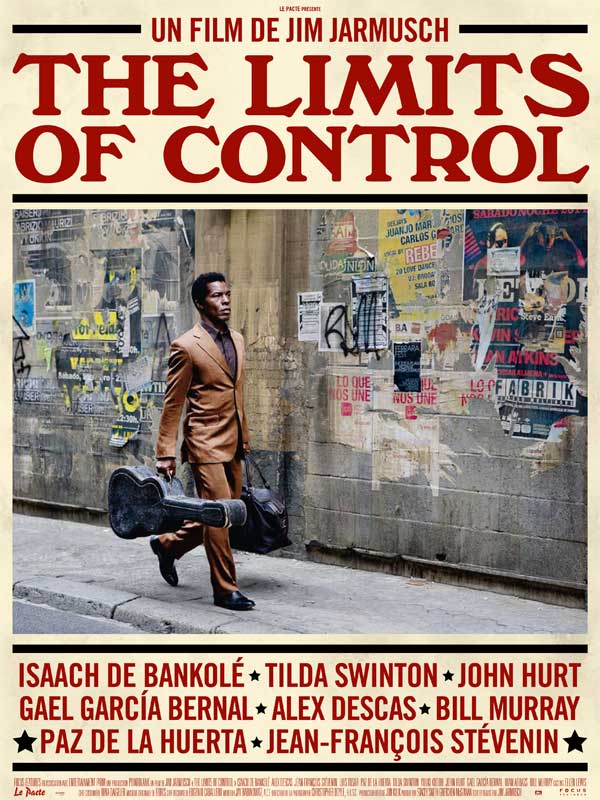Je remonte cette chronique datant d'octobre suite à un troisième et dernier edit consécutif à la lecture des Chroniques scandaleuses de Terrèbre, dernier avatar du cycle en question qu'il me restait à lire. Outre un remaniement de la forme de l'article pour qu'il ressemble un peu à quelque chose, c'est l'occasion d'étoffer la partie sur Les Jardins statuaires et Le Veilleur de Jour, parce qu'ils le valent bien.
Jacques Abeille est un auteur fantastique français influencé par le surréalisme...ce qui reviens à ne pas dire grand-chose d'une oeuvre trés difficilement classable.
Le Cycle des contrées, son oeuvre maîtresse, parus pour l'essentiel dans les années 80 et constitués de romans pouvant se lire de façon autonome, a ceci de commun avec Sur les falaises de marbre d'Ernst Jünger et Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq de prendre pour cadre des pays impossibles à situer et pourtant non dépourvus de références à notre monde (bon, celles-ci sont beaucoup plus rares chez Jacques Abeille, c'est vrai).

Le cycle a connu tout récemment une nouvelle jeunesse éditoriale grâce à la réédition de cette année, aux toutes jeunes éditions Attila, du premier roman, Les Jardins statuaires (les autres sont actuellement réédités par les éditions Gingko )
Pour la petite histoire, l'illustration de la couverture a été confié à l'illustre François Schuiten, qui, fasciné par cette oeuvre et y voyant une similitude avec son propre univers de la BD Les Cités obscures, qu'on ne présente plus, s'est empressé de collaborer avec l'auteur pour un mini-roman illustré situé dans l'univers des contrées, Les mers perdues, dont j'aurais l'occasion de reparler avant la fin de l'article.
Le mieux pour faire ressortir toutes les qualités de ces romans est de les chroniquer un par un, car ils sont trés divers.
Les Jardins statuaires est certainement le meilleur, empli d'un souffle qu'on ne retrouve plus, malgré leurs qualités, dans les romans suivants.
Le narrateur, un voyageur aux ambitions d'explorateur, arrive dans le pays des jardins statuaires, où les statues poussent dans la terre, phénomène autour duquel toute une société s'est organisé. Et c'est là le point central d'un roman que l'on pourrait qualifier d'ethnologique. En effet, les cent premières pages au moins ne comportent aucune action, il s'agit pour notre voyageur de découvrir, par ses visites des domaines statuaires, ses entretiens avec des personnages encore esquissés, la civilisation des jardins statuaires, ses coutumes et ses rites, dans ce qu'ils ont de fascinants mais aussi, par un réalisme bienvenu, rebutants, notamment pour ce qui est de la place des femmes.
Peu à peu, de nouveaux enjeux apparaissent, les personnages s'épaississent. Notre narrateur part vers le nord, rencontre l'amour en chemin dans un domaine statuaire dévasté, puis s'aventure briévement au-delà des jardins, dans les steppes du nord où les nomades commencent à s'organiser derrière un nouveau chef originaire des jardins et préparent la grande guerre de conquête dont le menace plane sur les deux premiers romans du cycle.
Se profile alors une réflexion qui traverse tout le cycle sur l'avancée de l'Histoire (la tradition n'est jamais figée pour Abeille, ce que le roman dévellope avec une étonnante subtilité). Cette réflexion n'est nulle part aussi dévellopée que dans ce premier roman, pour la raison évidente que le narrateur est explorateur, nous dirions dans notre monde ethnologue. A travers le frémissement interne de la société des jardiniers, mouvement où la place de la femme est bien entendu centrale, et l'intitiation ethnologique de son narrateur, Abeille démolit agréablement un certain traditionnalisme béat répandu chez les ethnophiles de comptoirs. A une époque où les crypto-fascistes de la "Nouvelle Droite" justifient leur critique virulente des Droits de l'Homme par un tiers-mondisme hypocrite, en se permettant de récupérer Levi-strauss de manière honteusement déformée, une réflexion aussi subtile fait du bien par où elle passe.
Au destin des jardins statuaires, se mêle le parcours intérieur du héros, et c'est là que l'auteur se montre le plus brillant, dans des pages contemplatives de toutes beauté, rendues par une prose poétique ciselée, aux phrases volontiers longues et alambiquées, mais maîtrisées.
Et je ne vous parle même pas des visions qu'Abeille tire du théme forçement prometteur des statues animée de vie végétale, et que n'aurait pas renié ses maîtres surréalistes. Là, il s'agit vraiment d'un élément qui ne se retrouve que dans ce roman.
Je n'hésiterais pas à dire que s'il fallait ne lire qu'un épisode du cycle, ce serait celui-là.
La suite du cycle, justement, qu'en est-il ? Eh bien, il faut avouer qu'une certaine originalité se perd, celle de l'imagination ethnolgiques. La description fascinante des jardines statuaires, digne d'un Borges au mieux de sa forme, ne trouvera plus d'équivalent dans le cycle...ce qui ne veux pas dire du tout que celui-ci perde tout interêt, bien au contraire !

Le deuxième roman, Le Veilleur du Jour, nous emméne de l'autre côté de la frontière ouest des jardins, dans la grande ville de Terrèbre, figure centrale du cycle.
Le héros, Barthélémy Lécriveur (on ne sait curieusement son nom qu'à la page 130, paradoxal pour un personnage évoqué en fin de roman précédent dans un but évident d'en préparer le suite) arrive dans la grande mégalopole et trouve un emploi curieux : "veilleur de jour", pour le compte d'une société d'archéologues férus d'occultisme, dans un entrepôt à la construction immémoriale ; le but du veilleur de jour : se préparer à accueillir un héros qui doit venir un jour dans ce monument, gardien lui-même d'un cimetierre oublié.
Ici, plus de première personne, la narration omnisciente permet d'introduire de multiples personnages : Coralie, l'étudiante qui se lie d'une relation passionnelle avec Barthélémy, l'inspecteur Molavoine qui découvre un nouveau sens à sa vie terne dans les mystéres de cette affaire, le professeur Destrefonds ami du grand chancellier et par là témoin de la dérive totalitaire de l'empire de Terrèbre. Ce tissu donne une ampleur plus épique à l'ensemble. Nénmoins, le lecteur guère porté vers le méditatif risque de s'ennuyer ferme au fil des 600 pages du plus gros roman du cycle -moi-même ai trouvé quelques longeurs par moment.
Pour compenser, il n'y a certes plus l'éblouissante exploration des jardins statuaires. Terrèbre est une ville d'apparence tout ce qu'il ya de plus occidentale, où les noms sonnent même français, bien que par une étrangeté qui refléte celle de tout un univers, il est trés difficile de la situer dans le temps. Mais sans vaine comparaison avec la civilisation du roman précédent, il faut admettre que cette héroïne à part entière de ce roman-ci vaut quand même son pesant de mystéres et d'ambiances, avec ses secrets millénaires, ses passages secrets dignes d'un roman gothique, ses références symboliques au Tarot de Marseille, tous éléments qui transforment cette fresque urbaine en roman d'aventure au subtil parfum d'ésotérisme.

Vient ensuite, dans la ligne générale de Gingko (qui a pour ainsi dire créé ce roman en 2008 à base de textes épars et d'inédits) Les Voyages du fils. Le fils, c'est celui de Barthelemy Lécriveur, vingt ans aprés, c'est à dire vingt aprés la disparition d'un père qu'il n'a jamais connu et, historiquement, le reflux vers le nord des barbares des steppes qui ont jadis détruit la ville.
Le fils, narrateur du roman, part enquêter sur le passé de son pére -par ailleurs amnésique dans le précédent roman-, dans les Hautes Brandes, la contrée qui sépare l'empire de Terrèbre des jardins statuaires, où vivent les sociétés tribales des bûcherons et des charbonniers...on y revient donc, à l'ethnologie !
Si la société des bûcherons et des charbonniers n'a pas le grandiose borgesien des jardins statuaires, elle offre tout de même de belles pages. Cependant, toute la description des coutumes et des rites est tournée vers le but de l'enquête du narrateur. Celui-ci apprend ainsi que son pére a usurpé l'identité d'un autre aprés sa perte de mémoire qui l'a ravalé au rang de bête. Il s'agit littéralement d'un échange de personnalité qui fait basculer une partie de livre vers un fantastique étrange.
Ce fantastique, justement, se cultive bien plus ouvertement, plus que dans tout le cycle, avec le passage de "l'auberge verte", saynéte autonome qui revisite magnifiquement le mythe de l'enchanteresse dans son repére hors du temps.
En revanche, aprés cet éclat, la deuxième moitié de ce roman, déjà nettement plus court que les autres, m'a bien moins convaincu. Il s'agit du retour à Terrèbre, où le jeune homme fait la connaissance de son oncle, l'écrivain pornographe Léo Barthe, et l'aide à publier un texte licencieux concernant son pére. Malgré son intéressante mise en abîme du métier d'écrivain, l'intrigue de m'a guère passionné, pas plus que la ville de Terrèbre ( que je découvrais avec ce livre, deuxième dans mon ordre de lecture) ici vidée de sa substance comme si l'auteur en avait fait le tour.

Ceci ne m'encourageait guère (comme s'en souviennt peut-être ceux qui ont lu les premières moûtures de ce billet) pour le tome 4, Les Chroniques scandaleuses de Terrèbre, paru sous le pseudonyme de...Léo Barthe (courant pour les incartades érotiques de l'auteur) et présenté comme le manuscrit publié par ce personnage de roman. C'est le tout dernier que j'ai lu, aujourd'hui même, guére tenté jusque là de relire sous un autre angle l'histoire de Barthélémy et Coralie, alors que je faisais une petite overdose de Terrèbre.
Ma lecture ne pouvait me laisser, pour des raisons trés subjectives, qu'une impression mitigée, en ce qu'il s'ait de ce que ses éditeurs nomment pudiquement un roman érotique, mais pour lequel le terme de porno n'est pas exagéré. Or je ne suis pas forcément amateur de ce genre de littérature qui, comme elle l'a prouvé dans le cas présent, ne fait pas sur moi, euh, l'effet escompté.
Cependant, pour un boulard, si vous me passez l'expression, ça n'en reste pas moins de la littérature aussi classe que n'importe quel roman des Contrées. Pour être clair, le roman ne peut à mes yeux s'apprécier pleinement qu'à l'aune du Veilleur du jour dont il est complémentaire, et devient même incompréhensible sans l'intrigue du Veilleur en tête. Il s'agit de présenter de l'épopée urbaine nimbée d'ésotérisme qu'est Le Veilleur du jour, une facette beaucoup moins noble et plus repoussante...tout en gardant paradoxalement l'aura proche d'un messianisme diffus qui caractérise le couple Barthelemy/Coralie, offrant ainsi de véritables instant de poésie à travers les témoignages qui constituent cette histoire parallèle (précisons que deux récits, au début et à la fin, sont à part, ne parlant pas du couple central) et dont les témoins voyeurs ont tous été bouleversés d'une façon où d'une autre par le couple. Bref, le roman apporte plus que je ne le craignais au Cycle des contrées qui reste au moins autant un style qu'un univers.
Voilà les quatre tomes de la série emballés et pesés...mais ce n'est pas fini, car la structure complexe du cycle dépasse ce concept de série, comptant beaucoup de textes périphériques.

Commençons pas La Clef des Ombres, paru chez Zulma en 1991. Le roman prend place à Journelaime, ville provinciale de l'Empire de Terrèbre, où vit un certain Brice, un petit fonctionnaire au physique ingrat et un peu simple d'esprit sur les bords, méprisé par ses collégues de la sous-préfecture.
Mais la vie commence à changer pour Brice. Il se rend compte que chaque nuit, il parle en état de somnanbulisme avec un inconnu dans un parc, lequel lui fait participer à un complot contre le totalitarisme montant de Terrèbre (dont nous avons déjà parlé) alors que l'esprit de Brice s'éveille à l'intelligence. Dans la foulée, le jeune homme, indécrottable rêveur, commence à douter de réalités qu'il toujours admises, comme l'existence de Séverine, la servante de la pension où il vit, dont nous ne saurons jamais si elle est une invention de son esprit -en tout cas c'est l'occasion d'un labyrhinte onirique tout à fait sublime.
La métamoprhose devient plus radicale dans la troisième et dernière partie, où en plus d'être plus malin Brice devient beau et commence à mener une vie de séducteur, tandis qu'il s'extrait de sa condition sociale. Pas de panique, ce n'est pas un conte de fée aussi niais que viriliste, mais au contraire une fable trés noire où notre rêveur idéaliste évolue vers l'archétype du conformisme...ce qui prend un sens trés spécial dans le contexte dictatorial de Terrèbre !
Bref, moi qui pensait que ce roman n'apporterait pas grand-chose à cet univers, j'ai été agréablement surpris, surtout, il faut dire, par l'histoire de Severine qui est peut-être le sommet du cycle du point de vue de l'onirisme.

Viennent ensuite les textes courts, avec Les Carnets de l'explorateurs perdus chez Ombre en 1993, qui renoue de fort belle façon avec la fibre ethnologique du cycle.
Il s'agit d'un court recueil (un peu plus de 80 pages) de textes attribués à Ludovic Lindien, autrement dit le narrateur des Voyages du fils, fils de Barthelemy. Ludovic est devenu anthropologue, et nous livre d'abord son enquête, appuyée de fantastique témoignages, sur le mystérieux peuple d'amazones alliés aux barbares des steppes dans la destruction de Terrèbre, puis un récit plein de magie païenne d'un jeune guerrier des steppes sous l'égide de son maître, un éclairage inattendu sur la préhistoire probable des jardins statuaires, et enfin l'étude des peuplades du Désert d'Inilo, à travers deux mythes archaïques trés joliment pastichés et un court essai mythologique aux allures borgesiennes. Un trés beau retour au source, par ailleurs illustré par l'auteur de troublants corps déformés.
Les deux textes suivants sont (pour l'instant, je vais y revenir) à réserver aux fans hardcore de ce cycles, en raison essentiellement de leur rapport quantité prix prohibitfs (8 euros pour 30 pages, comme vous pourrez le vérifier sur le site des éditions Deleatur, qui pratiquent la vente directe).
L'écriture du désert est dans la continuité du précédent puisqu'il s'agit encore du désert d'Inilo. On n'en regrette que davantage qu'il n'ait pas été regroupé aux Carnets où ce récit borgesien trés didactique avait davantage sa place et des chances d'intéresser un lectorat.
Louvanne en revanche est d'un style plus accrocheur. Son lien avec les contrées est léger puisqu'il est absent du texte même, n'apparaissant à ma connaissance que dans la liste des oeuvres d'Abeille dans quelques livres du cycle et surtout dans la carte des contrées jointes au Voyage du fils. Mais ce statut un peu flottant n'ôte en rien de son interêt propre à ce conte rural âpre, à l'ambiance sauvagement païenne, où même la vie d'une créature maléfique (la femme-louve qui donne son titre au récit) peut être taboue.
Pour en finir avec les textes périphériques, je vous renvoie à l'article à part que j'ai réservé, en raison de son statut particulier au confluent de deux oeuvres, à cette séquelle inattendue qu'est Les Mers perdues de Schuiten et Abeille.
Enfin, parlons du devenir du cycle. J'ai il y a peu envoyé un mail aux éditions Deleatur, co-éditeurs avec Gingko du Veilleur de jour, des Voyages du fils et des Chroniques scandaleuses de Terrèbre, pour avoir des nouvelles des deux prochains romans. Ceux-ci sont abandonnés mais repris par Attila, au moins pour le tome 5, un retour au Jardins statuaires qui devraient clore magnifiquement le cycle (EDIT de juillet : la parution des Barbares est maintenant chose faite, ainsi que sa chronique sur le blog ).
Clore le cycle, et le tome VI alors ? C'est qu'il s'agit plutôt d'une sorte de bonus, un regroupement de textes périphériques, dont les trois nouvelles et novellas citées ci-dessus (qui deviendrons alors financiérement abordables...en espérant que le projet aboutisse) (EDIT de septembre : en fait c'est plus compliqué que ça, depuis les informations fournies par Deleatur le programme a un peu changé). (EDIT de septembre 2012 : et il est temps de faire un erratum sur la parution de ce qui aurait pu être le septième tome).
En attendant, concluons ce billet avec les lien de deux autre chronique des Jardins statuaires :
Sci-fi universe
ActuSf
Plus l'ensemble des articles sur Jacques Abeille sur la taverne du Doge Loredan, soit certainement l'un des topos les plus complets et fournis que vous pourrez trouver dans la blogosphère sur ce cycle, depuis qu'un blog qui lui était entièrement dédié a été supprimé pour cause d'invasion de spams : link