Il va encore me falloir faire aveu d'incultance : je ne connais pas grand-chose, peut-être moins que la moyenne de ma génération, au cinéma Japanim' (sans blague, avec l'incontournable Miyazaki et un seul autre Ghibli, le premier Ghost in the Shell, Steamboy de Katsuhiro Otomo et Amer béton de Michael Arias, je dois avoir à peu près fait le tour). Ce fut donc un plaisir de soigner mon incultance avec un week-end dédié, dans un cinéma d'art et essai que j'affectionne, au grand Satoshi Kon, avec la projo de Millenium Actress suivi le lendemain de PAPRIKAAAAAAAAA (mais pourquoi je crie comme ça moi ?).
Cette authentique expérience devrait d'ailleurs être prochainement suivie du visionnage de Perfect Blue, d'où le numéro I dans le titre de cet article.
Ah, j'ai omis de préciser que la double projection se plaçait dans le cadre d'une théma rêve (la même que Rêves de Kurosawa ), de quoi rappeler que le rêve est le thème de prédilection du réalisateur, et c'est bien ce que j'ai pu vérifier à la vue de ces deux films.
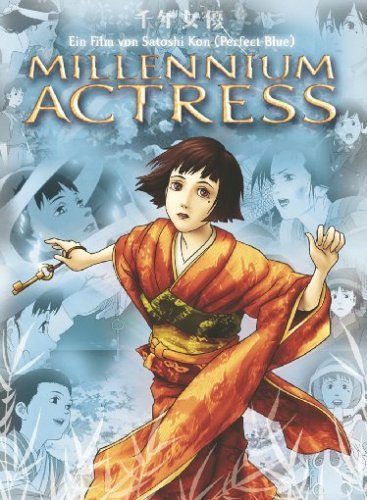
Lançons donc les hostilités par Millenium Actress...comme le titre le laisse deviner, l'histoire d'une célèbre actrice, Chiyoko Fujiwara, retirée du monde dans ses vieux jours depuis une trentaine d'année, et qu'après la démolition de son légendaire studio, viennent visiter le réalisateur de documentaire Genya Tachinaba et son caméraman. Leur documentaire sera bien plus excitant que tous deux ne se seraient jamais imaginé de prime abord, lorsque Tachinaba rend à celle qu'il faut bien appeler son idole une mystérieuse clé, celle qui ouvre "ce qui est le plus important". Il semble qu'il faille comprendre par là la passé de l'actrice, dans laquelle tout trois se trouvent à plonger.
La plongée commencent effectivement dans l'enfance de Chiyoko, ses débuts d'actrice, sa rencontre avec un peintre fugitif dont après son exil en Manchourie elle n'aura plus qu'une idée en tête : le retrouver.
Puis les choses se compliquent quand la clé permet de passer dans un second cercle, les propres film de Chiyoko. Quand je dis que cela compliquent les choses, c'est que le réalisateur ne se contente pas de nous promener d'un monde à l'autre, mais entame le véritable sujet de son film en brouillant les frontières entre réel et fiction (il commence en fait avant l'immersion dans un métrage de Chiyoko) et là, tout est fini, la tuerie commence.
L'égarement tourne autour d'un élément central : l'obsession de Chiyoko pour le peintre fugitif, qu'elle rechercerchera toute sa vie tout en ne se souvenant même pas de son visage (de fait, le spectateur ne le distingue jamais). Un tel argument semble a priori bon pour un film à l'eau de rose, étayée par l'aveu de Chiyoko qui dévorait les magazines féminins et leurs romances dans sa jeunesse, et le fait que retrouver le jeune homme soit la principale motivation de son premier tournage en Manchourie...du coup, j'ai vu sur la toile des chroniques du film qui, sans vouloir en aucun cas contester leur droit d'être négative, semblait avoir raté en grande partie l'interêt du métrage en prenant un peu trop au premier degré cet argument romantique.
En vérité, ce cliché cinématographique, car il s'agit bien de cela, n'est que d'un prétexte au réalisateur pour construire son labyrhinte. En effet, la quête de Chiyoko se reproduit par un hasard irréaliste dans ses films, dans des scènes de tournages qui ne nous sont bien sûr pas tout de suite révélées comme telles, de sorte qu'il est pour ainsi dire impossible d'en reconstituer la trame réelle. Sans entrer dans des détails oiseux, qu'il me soit permis de citer un exemple assez étonnant : une double scène où la rencontre de Chiyoko et du fugitif se reproduit, avec une importante divergence dans la suite, dans un film d'aventure se situant dans le Japon médieval.
D'autres éléments viennent encore compliquer le labyrhinte : le leitmotiv du tremblement de terre, dont je préfére laisser la surprise (trop compliqué à résumer de toute façon) et qui offre la plus vertigineuse imbrication fiction/réel. Ou bien, sur un registre plus drôle, les interventions de Tachibana lui-même dans les films de Chiyoko, afin de sauver son idole ; entre sa maladresse et les anachronismes qu'il fait intervenir (un revolver en plein Japon médieval, par exemple), il appelle une délicieuse interrogation sur l'état initial, en son absence, des films où on ne sait même pas s'il remplace un quelconque personnage.
Bref, le labyrhinte du film et des films qu'il contient interroge le rapprot entre la réalité et le rêve, mais pas au sens où l'entend la science-fiction depuis Dick : plus qu'une réflexion sur le pouvoir du virtuel, Millenium Actress est tout simplement une réflexion sur l'Art, qui reviendra dans Paprika, également à travers le cinéma.
Ce qui implique que le film soit également une déclaration au cinéma, et que les mises en abymes soient une oeuvre d'art à part entière, et non un banal élément d'intrigue. Les mondes imaginaires dans lesquels nous voyageons consistent en extraits de film dont nous ne saurons rien, dont nous ne savons même pas déterminer si certains ont la même origine (avec cette improbable quête commune, forcément...) et cette hermétisme leur confére une poésie particulière (j'ai été particulièrment subjugué par la scène de dialogue avec la sorcière, qui revient d'ailleurs en manière de leitmotiv dans le film). Pour ceux (et celles) que trouveraient que Satoshi Kon aurait pu montter plus d'imagination dans son prétexte à nous égarer qu'une histoire d'amour un peu mièvre, cela est contrebalancé par le fait que Chiyoko joue la guerrière dans ses films. Ce thème concourt à leur aspect inattendu, comprendre par là le décalage avec ce qu'on prête à des films des années 40-50 ; ici, dont les plus anciens sont même censés être des films patriotiques, argument explicitement avançé par le directeur du studio devant la rigide mère de Chiyoko, hostile au métier d'actrice...et dont on peut douter du bien-fondé devant ces épopées sauvages et sensuelles où les femmes mènent la danse ; le décalage est renforçé sur le plan esthétique, les extraits de films étant en couleur quand les images d'archives historiques (où l'insertion de l'image Chiyoko est également travailéle, mais j'abrège) sont en noir et blanc, et étant en outre assortie d'une de ces bande-son techno-trance chère au réalisateur (je parle bien de Satoshi Kon, non parce que je me rend compte qu'il y a risque de s'y perdre, pour des raisons évidentes qui doivent réjouir le Monsieur) ; en somme, on est toujours dans le cinéma populaire un peu kitsh, mais plus proche des critères actuels du kitsh que ceux de l'époque à laquel ce cinéma est censé appartenir, et on dirait bien qu'il y a encore là prétexte à nous égarer.

Après ce feu d'artifice, que dire du plus délirant encore Paprika ?
Bon, on peut déjà commencer par le résumer : l'équipe d'un centre psychiatrique est confontée à un événement plutôt fâcheux : le vol des DC Mini, machines conçues par l'équipe afin de plonger dans les rêves des patients et comprendre leurs névroses, et dont le vol pourrait être dramatique. Parmi l'équipe, le docteur Atsuko, laquelle plonge dans les rêves sous l'identité de son alter ego délurée, Paprika. Elle sera la première à constater pour ses frais un élément inquiétant: les rêves ne commençent pas seulement à se mélanger les uns aux autres, mais à se mêler à la réalité. Oui, miam.
Bon, comme à la différence de Millenium Actress ce film relève du genre SF, je vais être obligé de faire une parenthèse didactique, oui je sais que je suis chiant avec ça, mais d'abord c'est MON BLOG, je fais C'QUE J'VEUX.
C'est à l'aune du thème des mondes virtuels, dont l'inspiration a priori est sans limite, que l'on mesure à quel point la essèfe est bien plus frileuse au cinéma qu'en littérature -il est bien connu dans le milieu qu'elle traine un solide retard thématique, qui certes se comprend par la difficulté essentiellement financière de monter un projet SF. Si l'on considére que le monde virtuel dans son ensemble offre autant de potentialité que le rêve, des films comme la trilogie Matrix ou, pour faire dans la références plus classieuse, Avalon de Mamuro Oshii ou ExisteinZ de Cronenberg peuvent déjà, éventuellement, sembler tiède. Que dire d'Inception de Nolan, dont le thème est sensiblement proche de celui de Paprika, au point de rendre la comparaison inévitable ?
Pour ne pas vous cacher ma mauvaise foi, j'ai aimé tous ces films à des degrès divers, mais ça ne m'empêche pas de penser qu'en comparaison avec l'explosion initiée en littérature par quelqu'un comme Philip.K.Dick, le cinéma manque un peu de cet épice (Paprika ? Pardon, réminiscence d'une scène du film, voyez-le, merde) que les nerds appellent sense of wonder.
(Bon, dans les grandes références, j'ai pas vu The Cell, mais quelque chose me dit qu'il n'égalera pas le film de Satoski Kon).
De fait, Paprika détonne tant le film est une véritable fête de l'imagination et de sens. Le labyrhinte onrique n'est pas du forcément l'interêt central du film, il m'a en tout cas semblé carrément plus vertigineux dans Millenium Actress, mais les images de Paprika sont tous simplment stupéfiantes, puisant à une véritable inspiration surréaliste telle que l'on en a vu que fort exceptionnellement au cinéma. Les rêves ressemblent tantôt à du Dali, ou du Max Ersnt pour la monstruosité, voir à du Topor (en tout cas, l'idée m'est venu spontanément, c'est bon signe), tantôt à des formes plus contemporaines comme le pop surrealism américain et son chef de file Mark Ryden , pour les scènes hallucinantes mettant en scène la marche des jouets. Les textes ne sont pas en reste, car les personnages devenant fous, à moins qu'ils ne soient simplement dans le lieu qui le permettent, c'est à dire leurs rêves, ont tendance à se montrer doué pour des improvisations poétiques qui semblent droit issues d'un recueil d'André Breton.
En voyant que ce blog compte deux catégorie "surréalisme", l'une en litté et l'autre au ciné, et que la première est celle qui sur le site compte le plus d'articles (21) à l'heure actuelle, vous imaginez aisément que ce catalogue d'idée ne m'a guère déplu. Et le luxe, c'est quand même que tout cela a une intrigue, rigoureuse comme celle d'un thriller, dépassant ce genre même par la spéculation science-fictive ; ainsi la tension monte jusqu'à un climax final où, là, on se prend vraiment le sense of wonder en pleine poire.
Bon, je vais quand même me calmer avec le sense of wonder, car cette expression, qui n'est pas seulement récupérée par la culture SF en général, mais en particulier par une élite marginale de la SF depuis, notamment, un gigantesque débat intellectuel vieux d'à peine deux ans et que je vous épargne, cette expression ambigue pourrait entrainer des malentendus. Pour les nerds les plus puristes, le sense of wonder, c'est à dire le vertige provoqué par les spéculations de l'imagination, n'aurait guère d'interêt, tout comme le genre SF dans son ensemble, s'il ne visait à nous ouvrir les yeux sur la place de l'homme et de la science dans l'univers, sur la vie, la mort et le reste. Aussi pertinente, sans ironie aucune, que soit cette association, elle me semble d'autant plus l'arbre qui cache la forêt que l'expression a également été associée à l'Âge d'Or des pulps, donc au divertissement exotique et facile. Et le problème de Satoshi Kon, c'est qu'il ne rentre ni dans l'une ni dans l'autre de ces cases.
Il y a bien une once de réflexion scientifique dans le film, à travers un jeu de faux-semblant pas franchement imprévisible visant à nous montrer que ceux qui se réclament juste de la prudence dans la science sont moins dangereux que ceux veulent la proscrire, ce genre de connerie quoi. Cela ressemble en vérité davantage à une leçon de morale (qui a au moins le mérite d'être progressiste, comme l'est de nos jours toute bonne SF depuis que la hard science et l'essor de la culture geek ont dissous nos anciens complexes civilisationnels), qu'à une véritable réflexion. C'est que l'interêt du film n'est pas là : comme je l'ai dit, il a de commun avec Millenium Actress d'être une réflexion sur l'Art, et plus précisement, le cinéma. Le cinéma, c'est la passion du personnage du détective Konakawa, et cette passion n'inspire pas seulement ses rêves, mais offrent une garde partie de clés de l'intrigue onirique. Les DC Mini elles-même ressemblent davantage à de l'art qu'à de la science, leur inventeur étant une espèce de geek infantile designé comme un génie, qu'on jugerait plus inspiré que rigoureux. Finalement, ce n'est pas un hasard si les références plastiques citées ci-dessus me sont venus en tête dés visionnage. La conclusion du film ne laisse d'ailleurs aucun doute sur ce qui intéresse le plus le réalisateur, entre le cinéma et la science.
C'est d'ailleurs à se demander la raison précise qui a poussé Yasutaka Tsutsui, l'auteur du roman Paprika, à commander l'adaptation de son roman à Satoshi Kon...après avoir vu Millenium Actress. On dirait qu'il y a là comme une rencontre d'inspirations.
 Du réalisateur danois Dreyer, j'avais déjà vu, en ayant oublié qu'il s'agissait de lui, le film franco-allemand Vampyr (1932) chez-d'oeuvre expressioniste à l'esthétique très particulière (il fut tourné avec une caméra donnant une image floue, à la suite d'un défaut technique dont le réalisateur apprécia le résultat). Le visionnage de ce film au cinéma (projeté en 16 mm !) fut une expérience pour le moins curieuse, hypnotique dans les deux sens, celui de soporifique et celui de fascinant, me laissant dans un état second auquel les conditions de projection (son très bas pendat une partie du film, notamment) ont sans doute contribué.
Du réalisateur danois Dreyer, j'avais déjà vu, en ayant oublié qu'il s'agissait de lui, le film franco-allemand Vampyr (1932) chez-d'oeuvre expressioniste à l'esthétique très particulière (il fut tourné avec une caméra donnant une image floue, à la suite d'un défaut technique dont le réalisateur apprécia le résultat). Le visionnage de ce film au cinéma (projeté en 16 mm !) fut une expérience pour le moins curieuse, hypnotique dans les deux sens, celui de soporifique et celui de fascinant, me laissant dans un état second auquel les conditions de projection (son très bas pendat une partie du film, notamment) ont sans doute contribué. 


 Film vu à l'occasion d'une improbable édition européenne du new yorkais "Philip.K.Dick film festival", qui a eu lieu...à Lille, dans ma résidence second...euh, je veux dire, à l'Hybride, cinéma qui a beaucoup alimenté les pages de ce blaugue.
Film vu à l'occasion d'une improbable édition européenne du new yorkais "Philip.K.Dick film festival", qui a eu lieu...à Lille, dans ma résidence second...euh, je veux dire, à l'Hybride, cinéma qui a beaucoup alimenté les pages de ce blaugue.  Le Dirigeable volé est un film italo-tchèque réalisé en 1955 par Karel Zeman. Bien qu'il s'adresse en priorité à un public jeune -c'est dans une séance jeune public au sempiternel Hybride que je l'ai vu- il transcende largement cette classe d'âge.
Le Dirigeable volé est un film italo-tchèque réalisé en 1955 par Karel Zeman. Bien qu'il s'adresse en priorité à un public jeune -c'est dans une séance jeune public au sempiternel Hybride que je l'ai vu- il transcende largement cette classe d'âge. 





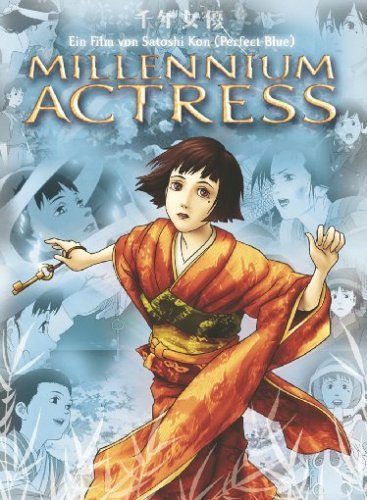


 et, Uzumaki d'Higuchinsky est sorti au Japon en 2000, mais une injustice malheureusement banale fait qu'en dehors de la soirée lilloise dont je parlais, où une unique bobine 35 mm a été projetée, il n'a pas été distribué dans les salles de ciné françaises. Il s'est donc contenté d'une sortie en Direct to Video, groupé avec un autre film parait-il médiocre (je jugerais par moi-même) mais quand même dans une collection dirigée par Jean-Pierre Dionnet, c'est déjà ça.
et, Uzumaki d'Higuchinsky est sorti au Japon en 2000, mais une injustice malheureusement banale fait qu'en dehors de la soirée lilloise dont je parlais, où une unique bobine 35 mm a été projetée, il n'a pas été distribué dans les salles de ciné françaises. Il s'est donc contenté d'une sortie en Direct to Video, groupé avec un autre film parait-il médiocre (je jugerais par moi-même) mais quand même dans une collection dirigée par Jean-Pierre Dionnet, c'est déjà ça.